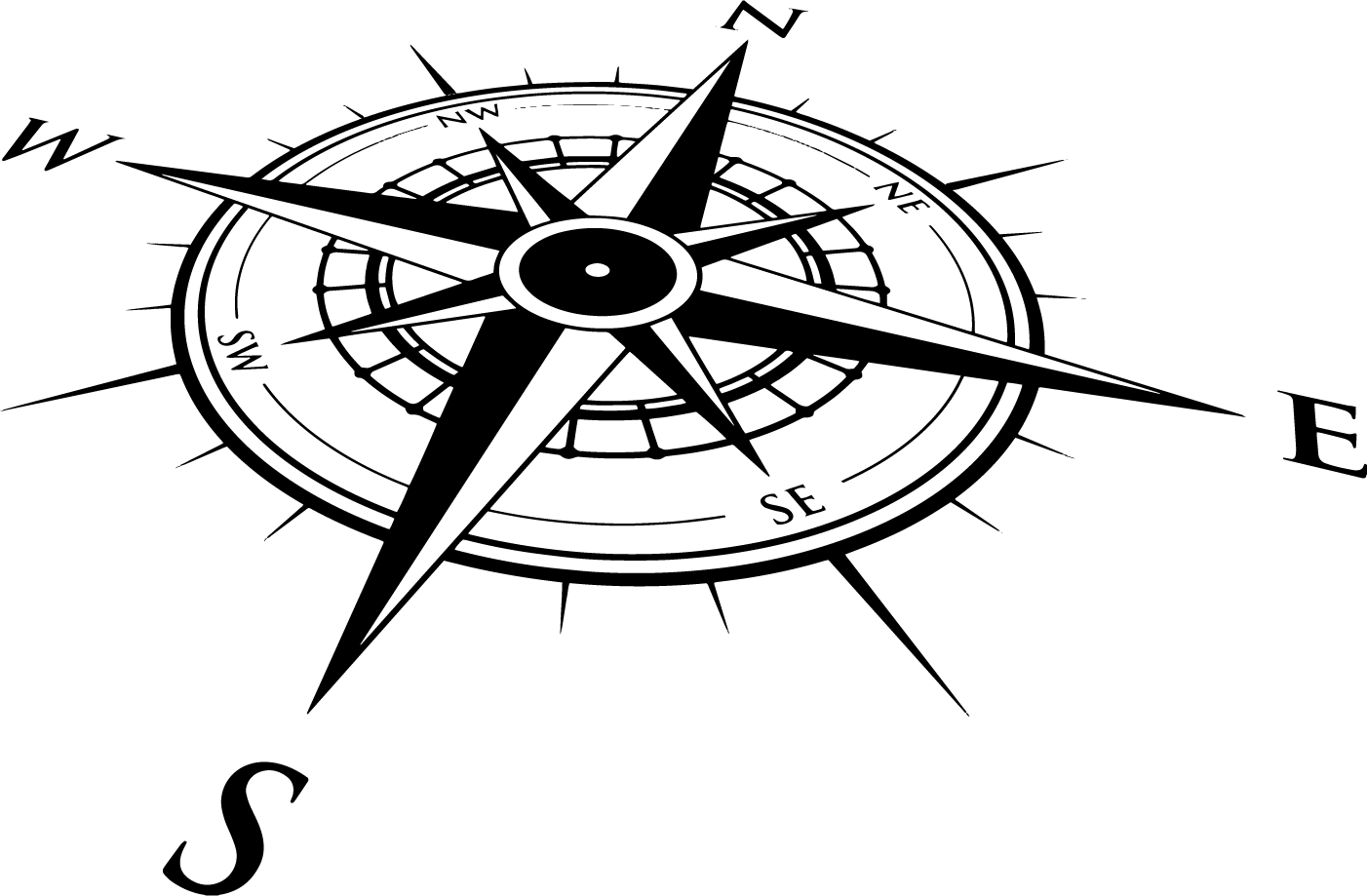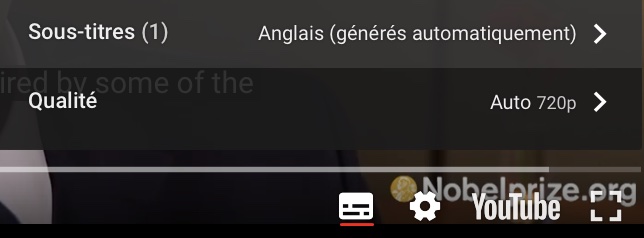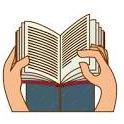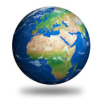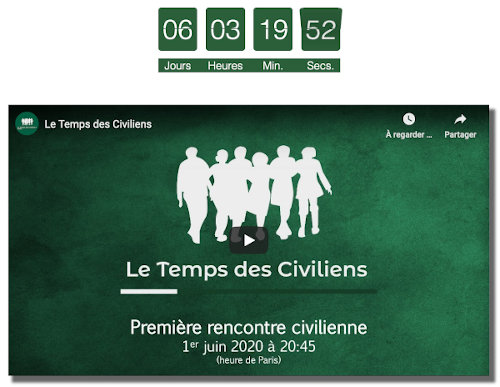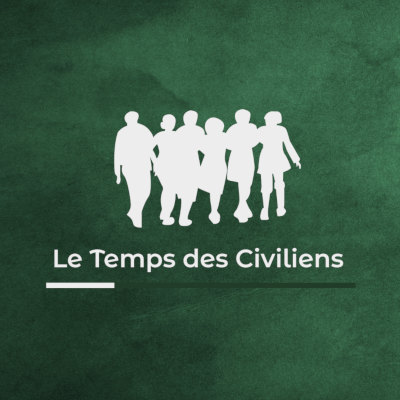Sur cette page nous rassemblons un échantillon de vidéos de témoignages d'anciens élèves, de parents et d'enseignants d'écoles Waldorf-Steiner. Les témoignages, surtout en langue anglaise, existent par centaines. Les témoignages écrits existent probablement par milliers... mais nous n'avons évidemment pas pris le temps de tout rechercher !
Il pourrait être intéressant de quantifier et de qualifier les témoignages "négatifs" et les témoignages "positifs" relatifs à cette pédagogie, ne serait-ce que pour se faire une image la plus objective possible de certains de ses points forts et de ses points faibles et sur cette base progresser. Or une telle étude portant sur 3000 témoignages récoltés en Allemagne avec une majorité d’interrogés (60,4 %) âgés entre 18 et 40 ans au moment de l’étude, existe déjà : voir sous l'onglet "Étude universitaire" ci-dessous. Les résultats de cette étude sont particulièrement intéressants.
Ce type d'étude n'est pas à confondre avec celles portant purement sur la réussite scolaire, par exemple.
Les vidéos Youtube ci-dessous sont extraites automatiquement de listes chaines vidéos externes, qui n'ont pas nécessairement été visionnées par nos soins et dont la qualité n'a donc pas été "éprouvée" par nous.
Les sources :
- ANPAPS : Association Nationale pour la Promotion et l’Avenir de la Pédagogie Steiner-Waldorf : https://anpaps.org/ et sa chaîne youtube.
- La Fédération des Écoles Steiner Waldorf en France: https://www.pedagogie-waldorf.fr/ et sa chaine youtube.
- Des vidéos directement issues de Youtube.
Comme à chaque fois, la mention de sites, de liens, de vidéos, d'articles et d'auteurs sur le site soi-esprit.info ne signifie nullement que l'éditeur responsable du site les cautionne nécessairement et vice-versa. Nous n'avons pas matériellement le temps de tout visionner !
Si vous souhaitez savoir comment obtenir des sous-titres en langue française en visionnant des vidéos, cliquez sur l'onglet "Sous-titres".
Stéphane Lejoly
- En français
- Autres langues
- Étude universitaire
- Sous-titres
- ?
Les témoignages ci-dessous en langue française sont issus pour la plupart de l’association de promotion de la pédagogie Steiner-Waldorf (ANPAPS) qui est née en 2001 d’une réaction citoyenne destinée à défendre cette pédagogie encore peu connue en francophonie mais qui se retrouvait alors sous les feux de critiques proférées par des personnes qui ne connaissaient pas (ou de très loin) cette pédagogie.
Outre les quelques vidéos présentées ici, plus d'une centaine de témoignages écrits (donc pas sous format de vidéo) sont accessibles sur la page suivante de l'ANAPS : https://anpaps.org/category/temoignages/
Parmi les vidéos publiées, une vidéo issus de la La Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf en France. De très nombreux témoignages écrits d'élèves sont aussi accessibles sur cette page de la Fédération : https://www.pedagogie-waldorf.fr/temoignages-avis-steiner-waldorf/
Témoignages d'anciens élèves d'écoles Waldorf-Steiner dans le monde, y compris un prix Nobel et plusieurs célébrités.
Il ne s'agit ci-dessous que d'une petite sélection de vidéos existant sur Youtube. Pour prendre connaissance d'autres vidéos (ainsi que celles qui seront publiées à partir de 2023), mettre les mots clé waldorf alumni panel dans la barre de recherche Youtube.
Selon la Fédération des Écoles Steiner Waldorf en France, une nouvelle étude universitaire massive confirme le haut niveau de satisfaction des anciens élèves Steiner Waldorf. Les quelques 3000 témoignages récoltés en Allemagne permettent également de mettre en lumière les points forts de cette pédagogie, et d’esquisser de précieuses pistes d’évolution.
«“Nous étions à l’école Waldorf” est le titre de la nouvelle étude sur les anciens élèves Steiner Waldorf allemands, parue en janvier 2021, menée par Dirk Randoll et Jürgen Peters, tous deux enseignants chercheurs à l’université d’Alanus (Bonn).
L’objectif : compléter et actualiser l’étude menée en 2007 à l’université de Düsseldorf sur le devenir des anciens élèves Steiner Waldorf, et leur perception de leur scolarité. La masse de données est impressionnante : près de 3000 anciens élèves ont été interrogés, autant pour recueillir des données factuelles (niveau d’étude, profession etc.) que leur vécu de leur scolarité (aspects positifs, aspects négatifs etc.). L’étude approfondit cette fois les différences de vécu entre différentes générations d’élèves (de 18 à 80 ans !), avec une majorité d’interrogés (60,4 %) âgés entre 18 et 40 ans au moment de l’étude.»
Plus d'informations très intéressantes sur la page "Les témoignages de 3000 anciens élèves analysés par la recherche universitaire" de la Fédération.
Au delà des témoignages, "la pédagogie Steiner-Waldorf prépare-t-elle convenablement les enfants aux études supérieures et à l’acquisition d’un métier ?". Plusieurs études universitaires mentionnées sur le site de la Fédération font le point sur cette question.
|
Souhaitez-vous visionner des vidéos avec des sous-titres en langue française ? Voici une procédure qui fonctionne avec certaines vidéos, mais pas toutes : Sur la vidéo concernée, cliquez sur le petit bouton qui représente l'image d'un texte. Le bouton est dorénavant souligné en rouge. Vous venez d'activer les sous-titres.
Enfin, cliquez sur "Anglais (généré automatiquement)" (ou équivalent). Vous voyez maintenant apparaître quelque chose semblable à ceci:
Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Traduire automatiquement" et vous faites ensuite le choix de la langue qui vous intéresse (le français dans notre cas). ASTUCE : il est aussi possible de ralentir ou d'accélérer quelque peu la lecture d'une vidéo sur Youtube. Il suffit ici aussi de cliquer sur la petite roue dentée et de faire le choix de la vitesse de lecture.
|
Auriez-vous identifié d'autres sources de témoignages encore (écrits ou en vidéo) qu'il serait pertinent de faire connaître via la présente page ? Si oui, merci de les faire connaître à soi-esprit.info.