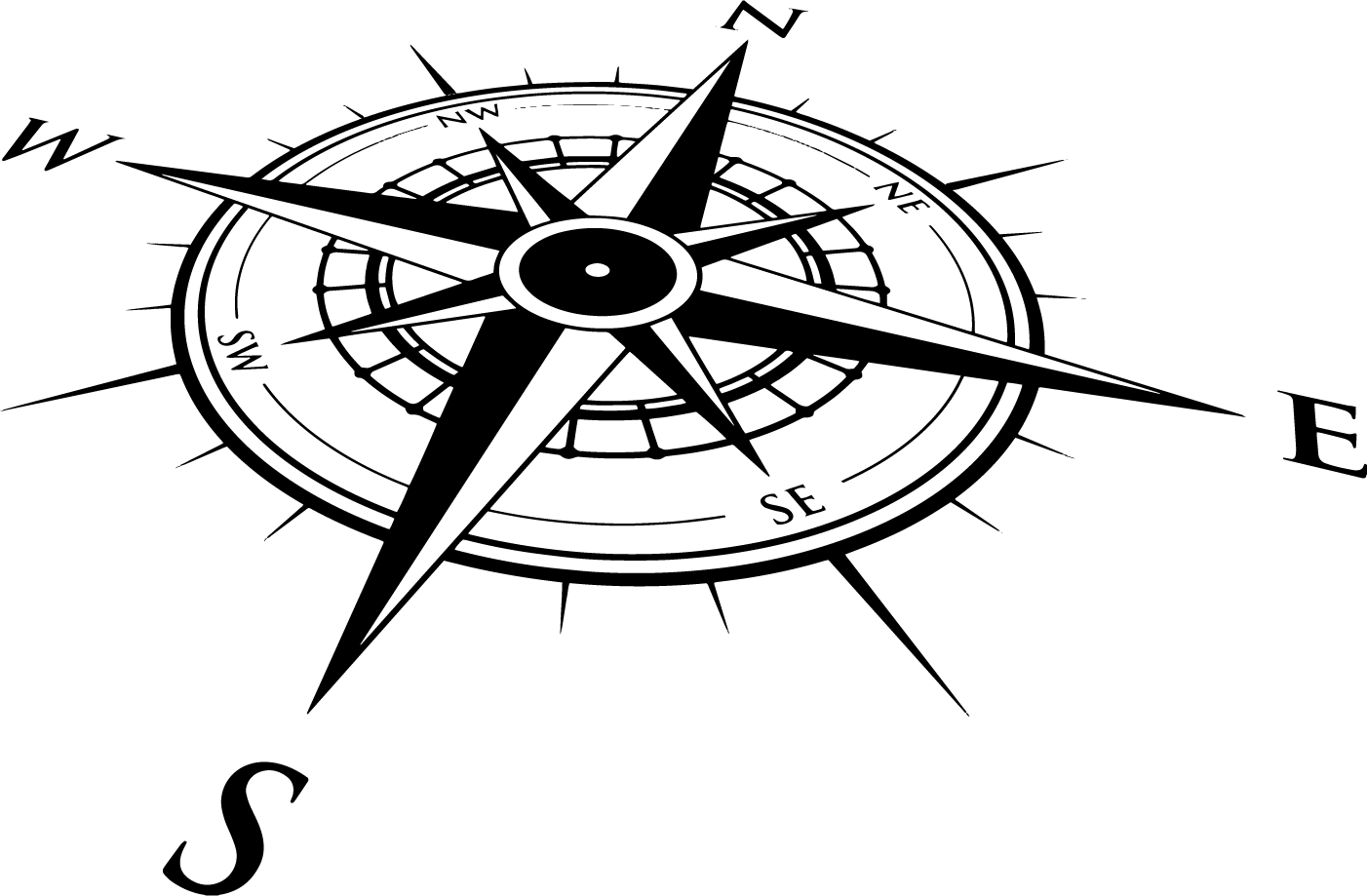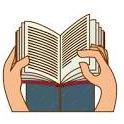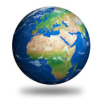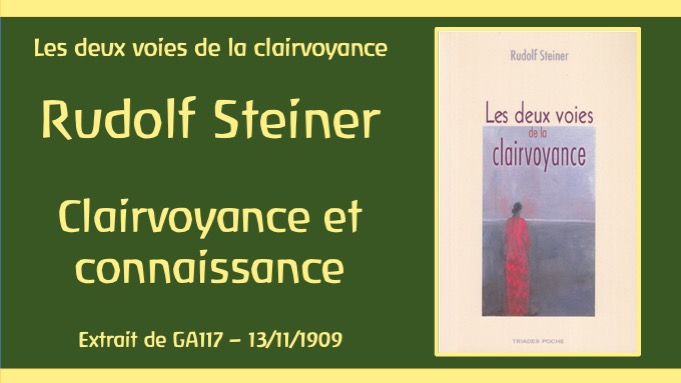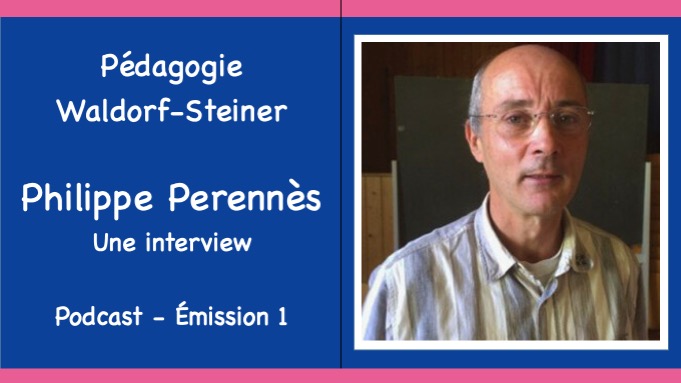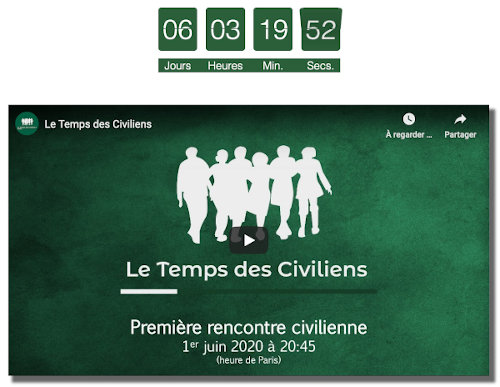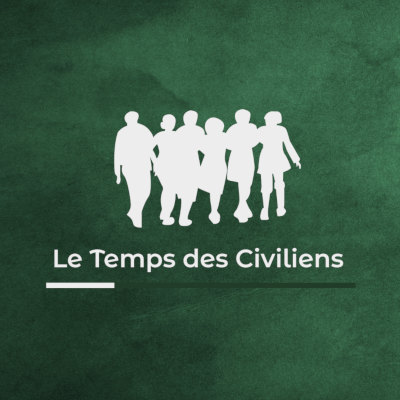Dante et Beatrice au paradis, selon Gustave Doré (1860)
Extrait du reccueil de conférences « Les arrière-plans spirituels de la Première Guerre mondiale »
Stuttgart, le 23 avril 1918 - 14ème conférence
Rudolf Steiner – GA174b
Éditions anthroposophiques romandes (2010) -
Traduction : Jean-Marie Jenni
(…) Songez que depuis de nombreux siècles, quand il est question de l’immortalité, on ne pense surtout qu’à ce qui vient après la mort. On se demande toujours : est-ce que l’homme peut transporter dans l’au-delà ce qu’il a développé au cours de sa vie physique ? C’est ce qui importe avant tout. Cette question de l’immortalité est certes importante, mais elle prendra un autre aspect lorsqu’on tiendra compte, je dirais, de son autre moitié, c’est-à-dire de la vie avant la naissance, lorsqu’on ne se demandera plus seulement : qu’est-ce qui advient après la mort ? mais surtout : comment ce qui se passe ici sur terre dans mon corps physique fait-il suite à ce qui s’est passé auparavant ?
Pour la vie que nous avons passée avant la naissance, notre vie ici sur terre est un au-delà. La pensée saisira de préférence cette direction-là du regard. Les êtres humains verront qu’ils ne peuvent comprendre la vie ici sur terre que s’ils la conçoivent comme une continuation de la vie de l’esprit dont ils sont issus. Ils commenceront de nouveau à s’intéresser à la vie qui a précédé la vie sur terre. On peut dire qu’hormis à la fin du 19e siècle, les êtres humains s’intéressaient encore à la question de l’immortalité, mais ce n’était toujours qu’à la partie qui fait suite à la vie terrestre. C’est ce que faisaient les érudits philosophes ; ils se réclamaient francs de tout préjugé, or ils étaient sur ce point de bien misérables ignorants, car ils ne faisaient que prolonger les préjugés de certains courants. Songez qu’à l’époque d’Origène[1] l’Église a condamné l’idée de la préexistence de l’âme, et qu’Origène lui-même a été condamné pour l’avoir enseignée. L’Église tomba d’ailleurs dans un affreux dilemme, car elle condamnait ainsi le plus grand Père de l’Église. Mais cette pensée fut interdite dans l’Église. Tout au long du Moyen Âge on a pris l’habitude d’ignorer l’enseignement de la préexistence de l’âme. Tout le monde a repris cela allègrement, les philosophes, les écrivains, les professeurs, tous prétendent être sans préjugés. Ils le prétendent d’ailleurs également dans d’autres domaines dont je vous ai donné ici déjà des exemples.
Il s’agit avant tout d’être au fait que l’orientation de la pensée, l’orientation de la conception du monde doit subir une inflexion sévère grâce à la science de l’esprit. La vie terrestre n’apparaîtra dans sa vraie valeur que si on la conçoit somme le prolongement de la vie de l’esprit. Elle n’est compréhensible que comme cela. Sous cet angle de vue, on obtiendra également un jugement plus sain sur l’autre face de la question. Lorsqu’on sera plus au fait de la signification de cette vie-ci pour la vie dans l’au-delà, lorsqu’on saura que l’être humain cherche à venir sur terre parce qu’il a besoin de l’expérience de la vie terrestre, alors on aura changé, bien plus que jusqu’à présent, les prémisses du questionnement concernant la valeur de la vie terrestre.
Voici un élément qui vous indiquera tout particulièrement combien il est important de se poser la question de la valeur de la vie humaine sur terre. On ne distingue généralement pas entre les deux propositions suivantes : « l’homme pense » et « l’homme a des pensées ». C’est pourtant fort différent. Penser est une force dont l’homme dispose, c’est une activité, et cette activité conduit à des pensées. Or cette activité de penser, cette force qui vit quand nous pensons, nous l’apportons avec nous, lors de la naissance, lorsque nous venons du monde spirituel dans lequel nous avons vécu entre la mort et une nouvelle naissance. Nous appliquons cette force de penser aux objets qui nous viennent du monde extérieur par nos organes sensoriels. Nous élaborons des pensées à propos du monde extérieur. Mais ces objets du monde extérieur n’ont aucune signification pour la vie entre la mort et une nouvelle naissance, car ils ne sont rien dans l’au-delà. Ils ne sont qu’ici pour nos sens. C’est pourquoi les pensées élaborées à partir des objets qui nous parviennent par les sens n’ont pas de valeur entre la mort et une nouvelle naissance ; ce qui compte alors, c’est d’avoir augmenté la force de la pensée, car cette force reste acquise tout au cours de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Les pensées obtenues à la suite des perceptions sensibles sont stériles après la mort. Elles ne servent qu’à procurer des points d’ancrage pour le souvenir que l’on a du moi dans la vie entre la mort et une nouvelle naissance.
Considérons deux personnes. La première ne se soucierait d’aucune science de l’esprit ni de ce qu’on peut connaître de la vie après la mort. Elle ne s’occupe que de pensées liées aux perceptions sensibles et de ce qu’offre habituellement la science, c’est-à-dire rien d’autre non plus que ce qu’offrent les sens. Elle attend d’être morte, c’est-à-dire d’être dans le monde spirituel pour s’occuper d’autre chose. C’est, entre parenthèses, une espèce moins mauvaise à certains égards que l’espèce, apparue à la fin du 19e siècle, et qui croyait devoir nier de toute la force de sa science l’existence d’un monde spirituel, selon l’adage d’un poète : « Aussi vrai qu’il y a un Dieu dans le ciel, aussi vrai je suis athée ! »[2] C’est à peu près de cet état d’esprit, « de ces riches contenus de l’âme », que s’est nourri l’athéisme du 19e siècle. Mais prenons un homme qui, sans nier l’esprit, ne voudrait tout simplement pas s’en occuper de son vivant. La seconde personne, au contraire, aborderait l’élaboration de pensées à propos du monde spirituel. Ce sont sans conteste des pensées différentes des premières, et c’est vite vu : les pensées qui n’accueillent aucun monde spirituel sont considérées généralement comme étant les pensées intelligentes, des pensées réelles, tandis que les pensées décrites par la science de l’esprit sont considérées généralement comme folles, fantaisistes, fantasques, etc.
Dans quelles situations seront ces deux personnes après leur mort ? Celle qui n’a pas nourri de pensées à propos du monde spirituel sera, en tant qu’être psychique après la mort, comme un organisme physique sans nourriture, elle sera affamée. Car les pensées que nous formons ici sur terre à propos du monde spirituel sont la nourriture de la force principale qui reste après la mort : la force de pensée. La force de pensée est, dans la vie entre la mort et une nouvelle naissance, comme la force de la faim ici-bas, mais alors elle ne sera pas rassasiée. Dans la vie entre la mort et une nouvelle naissance nous pouvons avoir des imaginations, des inspirations et des intuitions, mais nous ne pouvons pas avoir de pensées en tant que telles. Il faut les acquérir ici-bas. C’est pour acquérir des pensées que nous devons entrer dans la vie terrestre. Lors de notre vie entre la mort et une nouvelle naissance nous consommons sans cesse les pensées, et s’il n’y en a pas... c’est la famine ! Voilà la différence. Celui qui refuse de se forger des pensées à propos du monde spirituel se condamne à souffrir de la faim dans l’autre monde, tandis que celui qui cultive, comme nous le faisons ici, des pensées à propos du monde spirituel, pourra alors satisfaire sa faim. Si le matérialisme devait rester la seule conception du monde envisagée par les humains, ceux- ci souffriraient, dans la vie entre la mort et une nouvelle naissance, dirais-je, d’une famine épidémique. La conséquence serait alors que, dans leurs incarnations ultérieures, les humains reviendraient affligés de dépérissement, de rabougrissement. Le monde spirituel irait dépérissant et, par voie de conséquence, également la vie terrestre pour tout l’avenir que l’humanité est encore appelée à passer sur terre. On a réussi, d’une certaine façon, à répandre l’adage « après moi le déluge ! » dans une humanité ignorante, ignorante des conséquences. Bien que cet adage ne soit pas vraiment appliqué, il règne néanmoins dans les âmes de notre époque matérialiste. C’est un adage absurde pour quiconque connaît la réalité. Car l’action présente des êtres humains, leur intérêt ou non à immerger leur âme dans le monde spirituel, forme le sol du développement futur. Le salut de la terre dépend du fait que l’humanité d’à présent ne néglige pas de se forger des pensées à propos du monde spirituel. Il faut que de plus en plus, tous ceux qui vivent à présent reconnaissent cela. Tout dépend au plus haut point de la compréhension spirituelle de la marche du développement de l’humanité. (…)
[1] Origène, 182-253 après Jésus-Christ
[2] Ndt : en français on dit « Je suis athée, Dieu merci ! »
[Caractères gras et italique S.L.]
Rudolf Steiner
|
Note de la rédaction À NOTER: bien des conférences de Rudolf Steiner qui ont été retranscrites par des auditeurs (certes bienveillants), comportent des erreurs de transcription et des approximations, surtout au début de la première décennie du XXème siècle. Dans quasi tous les cas, les conférences n'ont pas été relues par Rudolf Steiner. Il s'agit dès lors de redoubler de prudence et d'efforts pour saisir avec sagacité les concepts mentionnés dans celles-ci. Les écrits de Rudolf Steiner sont dès lors des documents plus fiables que les retranscriptions de ses conférences. Toutefois, dans les écrits, des problèmes de traduction peuvent aussi se poser. |
Tous les articles de la catégorie Pensées anthroposophiques
- L'individualité humaine libre est-elle possible ou est-elle déterminée par l'espèce, l'ethnie, le peuple, le sexe, le collectif ?
- Une fête de Noël qui n'a plus de sens par méconnaissance de l’Être du Christ...
- Noël peut aussi rappeler la naissance du christianisme lui-même dans l'évolution terrestre
- Ce qui dans l'être humain est éternel dépasse les nations. Quelle est une des causes profondes (ésotérique) de la haine à l’égard d’une autre nation?
- Comment faire des gens de dociles instruments, en introduisant des symboles dans le subconscient ?
- L’établissement de rapports mutuels entre les vivants et les morts
- La mission de la vie terrestre comme point de passage vers l’au-delà
- Les représentants obéissants des sociétés secrètes prétendent que le peuple n'a pas la maturité suffisante pour accéder aux savoirs supra-sensoriels
- Ne peut comprendre l'école Waldorf que celui qui a adopté dans son cœur la science de l'esprit d'orientation anthroposophique
- Le courage de défendre le vrai christianisme et non celui de façade
- La perte de toute vénération face aux énigmes de la vie. Pour quelle raison ?
- Celui qui ne se pose pas la question du sens de la vie refuse l'esprit
- En règle générale, pour parler de l’immortalité, on fait appel au plus subtil des égoïsmes en l'être humain, celui de désirer la vie après la mort
- Idéalisme contre antisémitisme
- L’antisémitisme, une insulte à toutes les conquêtes culturelles de l'époque moderne (Ahasver)
- Un antisémitisme honteux
- Actions de Lucifer et d’Ahriman dans l’être humain. Un concept qui masque l’action d’Ahriman: le «hasard»
- Que se passe-t-il en chaque individu humain lorsqu'il passe par un processus d'initiation et que se passe-t-il pour la terre lors du Mystère du Golgotha ?
- Que requiert la compréhension du Mystère du Golgotha, à l’époque ACTUELLE ?
- L'humanité occidentale actuelle, à la traîne de l'Amérique, sombrera dans la barbarie si elle ne comprend plus le mystère du Golgotha
- On ne peut pas imaginer plus grande tyrannie que celle qui veut refuser l'étude d'un domaine qu'elle n'a elle-même jamais étudié et se refuse à le faire
- Au fond la simple croyance à la réincarnation et au karma ne conduit pas à grand-chose
- Comment l'âme peut-elle surmonter sa détresse présente ?
- Le caractère entièrement public de l’anthroposophie et la nécessaire différenciation entre dilettantes et experts
- Se présenter dans le monde sous le signe de la pleine vérité
- Les deux questions fondamentales à la base de la Philosophie de la Liberté
- Poser clairement le problème de la Liberté : réalité ou illusion ?
- Le penser repose... sur lui-même !
- La théorie de la relativité conduit à faire les premiers pas dans la science de l'esprit... si elle est pensée de manière conséquente
- Un point de vue sur l'évolution spirituelle de l'humanité au cours de la succession des civilisations
- Pourquoi il y a-t-il alternance entre incarnations féminines et incarnations masculines ?
- Spiritualités «d’en bas» versus «d’en haut»: catacombes versus Rome impériale – anthroposophie versus cultures scientifiques et spirituelles extérieures
- « La pensée du cœur » - Clarifications fondamentales
- Le matérialisme a son bien-fondé
- L’humanité est aujourd’hui seulement assez mûre pour comprendre le contenu spirituel de la loi de Karma et de réincarnation
- Le but et la nécessité de la vie alternée entre veille et sommeil, sans laquelle la vie sur la terre ne serait pas possible. Le lien avec le dépérissement du corps.
- Le mensonge, considéré spirituellement est un meurtre. Il est aussi un suicide.
- La «technique» du Karma
- La loi du karma: une loi universelle
- Pourquoi fixer la fête de Noël en hiver… et pas en été ? L’initiation consciente et l’initiation naturelle (notamment pendant les treize nuits de l’hiver)
- La fête de Noël et les trois principes : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
- Trouver l'harmonie entre l'amour entre les humains en général, d'une part, et l'amour de son peuple, d'autre part
- La part de responsabilité anglo-saxone dans la catastrophe de la guerre
- Quelques particularités fondamentales de l’évolution humaine au cours des périodes de civilisation : leur lien avec la maîtrise du corps physique et avec la conscience clairvoyante
- Celui qui perçoit le monde spirituel peut-il avoir une connaissance immédiate de tout (Omniscience) ?
- Pourquoi les communautés humaines ont-elles accordé de l'importance aux fêtes des morts de toute nature ?
- Pourquoi les livres anthroposophiques sont-ils écrits de façon si incompréhensible ?
- Mourir avant ou après l’âge de 35 ans. Quelques particularités des humains morts pendant leur jeunesse
- Le moment de la mort a une importance extraordinaire
- La vie du sommeil serait beaucoup plus active que la vie… de veille ! De quoi s'agit-il?
- Entre la mort et une nouvelle naissance il nous faut acquérir la faculté d’être un être humain dans la vie physique
- Les dangers de l’initiation occulte jésuite et son opposition la plus radicale avec le chemin de connaissance Rose-Croix
- Extraire l'enfant le plus vite possible de l'enfance : un faux principe d’éducation
- Quelques exemples d’impulsions lucifériennes et ahrimaniennes imprégnant la vie sociale
- Confrontations et discordes, comme conséquences de pensées abstraites de la réalité. Un exemple parlant.
- Un mensonge, même soutenu dans une bonne intention, agit comme un mensonge
- Si l’on avait une éducation du cœur et pas seulement de la tête, ce serait une source de jouvence
- Jamais il n’y eut, au cours du développement de l’humanité, des concepts et des représentations plus spirituels que ceux que notre science naturelle amène à la surface
- La grande maladie de notre temps, c’est la déclamation d’idées abstraites dénuées de valeur pour la vie réelle
- Charlatanerie et manipulations au sein d'un mouvement dit «spirituel»
- La mort des enfants, des jeunes et des adultes
- Réveil et endormissement sont les deux moments les plus importants pour la relation avec nos défunts
- Du matin au soir nous sommes à moitié endormis. La part endormie partage les mêmes réalités que nos défunts.
- L’être humain se développe au-dessus de la vie de l’État
- L’extorsion de l’initiation par les Césars romains et ses conséquences, à l’antipode du monde grec
- Une intention fondamentale dans toute la littérature anthroposophique: Éveiller l’autonomie des lecteurs
- Une histoire amusante qui montre le côté risible du matérialiste arrogant
- Développer une sensibilité pour la boule de neige qui provoquera une avalanche, alors que la volonté existe de tuer l’anthroposophie
- On cherche à détruire la science de l’esprit. Quelques exemples de cas concrets.
- Que signifie «se libérer de soi-même» pour développer des facultés de connaissance occultes? Quel chemin emprunter pour y parvenir?
- L’étude des réalités des mondes supérieurs, une auto-éducation qui transforme peu à peu l’âme
- Max Heindel, plagiaire notoire de Rudolf Steiner
- Quelle est l’importance du penser, du sentir et du vouloir après avoir franchi la porte de la mort ?
- Après la mort, tout ce dont l’être humain n’a pas le moindre soupçon pendant sa vie se dresse puissamment devant lui
- La relation avec les autres êtres humains après la mort, lors de la traversée du kamaloca. Désirs et convoitises camouflés ont une action d’autant plus intense après la mort
- Ce n’est pas le contenu des mots qui compte mais l’essence de la chose
- Deux expériences essentielles rencontrées très tôt au cours de la vie entre la mort et une nouvelle naissance (ainsi que par l’étudiant en occultisme)
- Penser – Sentir – Vouloir : une courte caractérisation
- Organiser le travail scolaire sur base d’une connaissance intime de l’être humain: exemples
- Ce que nous apprend la science : nous avons évolué en nous débarrassant des formes animales
- Pourquoi les êtres humains ne peuvent-ils plus être intérieurement unis au cours de l’année ?
- L'importance capitale des premiers pas dans la vie pour ce qui est déterminé par le destin
- Après la mort: une conscience incommensurable à atténuer pour pouvoir s’orienter
- Le cerveau en tant qu’appareil réflecteur - L’être humain construit selon les pensées du cosmos
- Une mémoire universelle incarnée : voilà ce qu’est l’être humain
- Tous les matins brille le cirage de la chaussure cosmique, ou la prétention d’avoir un jugement sur la totalité du monde à partir des seules lois de la physique, de la chimie, de la biologie
- Le tarissement des forces spirituelles et la nécessité que de telles forces soient générées par les êtres humains eux-mêmes
- Opposer une vie intérieure puissante aux impressions extérieures: un remède permettant de faire face à l’évolution culturelle?
- Se défendre contre tout ce que la technique a apporté dans la vie moderne? Ce serait commettre la plus grave erreur...
- L’amour que l’on croit porter à quelqu'un, le plus souvent pur égoïsme?
- Comment pouvons-nous contrebalancer consciemment les instincts antisociaux, qui se développent naturellement, par des instincts sociaux ?
- De la confiance que l'on peut avoir dans le penser
- Le processus que nous connaissons plus immédiatement et plus intimement que tout autre processus du monde: notre penser
- Pourquoi la majeure partie de la population reste-t-elle indifférente devant l’accroissement incessant du pouvoir médical ?
- Comment faudrait-il concevoir l’enseignement de l’anthroposophie pour les débutants ?
- Origines occultes du matérialisme de notre époque
- La patience, au sens occulte, est nécessaire pour comprendre la science de l'esprit
- Une différence essentielle entre le Grec et le Romain
- Au sujet de la nature des vérités anthroposophiques
- De la nature abstraite des concepts
- Action matérialisante du cinéma