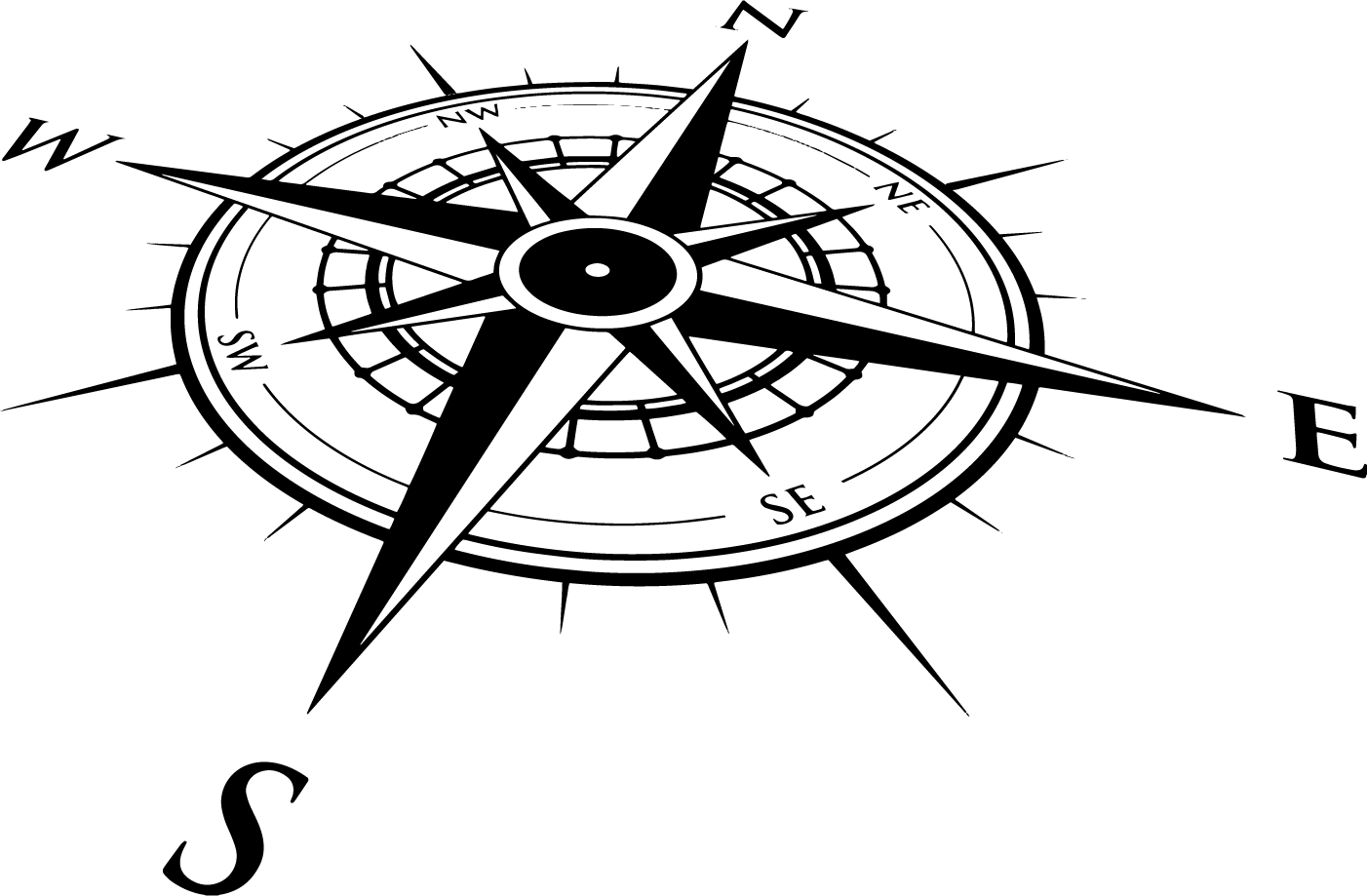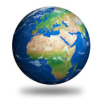À gauche : Jean-Marie Guyau - À droite : Friedrich Nietzsche
Publié sur Soi-esprit.info avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Publication originelle : Revue L'Esprit du Temps - N°1 - Printemps 1992
(Guyau-et-Nietzsche-sur-la-cote-d-Azur.pdf)
NDLR (Soi-esprit.info) : Christian Lazaridès a publié un ensemble de 9 documents portant sur ces individualités singulières que sont Guyau, Nietzsche, Soloviev et Steiner, lesquelles sont liées entre elles par des liens mystérieux, pour ne pas dire mystériques, qui pourront transparaître dans ces publications. Pour prendre connaissance de ces 9 PDF, les feuilletter ou les télécharger, cliquez ici.
Au chapitre XVIII de son Autobiographie Rudolf Steiner évoque sa lecture intensive des œuvres de Nietzsche à partir de 1889, et aussi sa « rencontre » avec le philosophe à Naumburg (près de Weimar, où Steiner travaillait alors aux Archives de Goethe). « Rencontre » doit être mis entre guillemets car Nietzsche est, depuis 1889 précisément, dans cet état de conscience crépusculaire qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort en 1900.
« Ces yeux qui, tout éteints qu'ils fussent, faisaient encore l'effet d'être pénétrés d'âme, n'appréhendaient plus de ce qui se trouvait autour d'eux qu'une image qui n'avait plus accès à l'âme. On était là, et Nietzsche n'en savait rien. (…) Un ébranlement intérieur qui saisit mon âme pouvait se dire qu'il se transformait en compréhension pour le génie dont le regard était dirigé sur moi, mais ne m'atteignait pas[1]. »
Steiner est ensuite chargé par la sœur du philosophe de mettre de l'ordre dans la bibliothèque de son frère, et c'est à cette occasion qu'il pourra constater, en feuilletant les livres lus et annotés par Nietzsche, que nombre des idées de sa dernière période de création étaient en fait des emprunts, certes reformulés, voire inversés, à tel ou tel auteur. On pourrait parler d'idées-réflexes ou de contre-pied. Ainsi l'idée de « l'éternel retour du même » se trouve chez Dühring, lu et annoté par Nietzsche, mais cet auteur voulait montrer l'absurdité de cette idée. Nietzsche retourne la chose et en fait un leitmotiv de ses dernières œuvres. Et ainsi pour Guyau dont deux livres fortement annotés se trouvent là et à qui Nietzsche emprunte la plupart des idées sur la morale, mais cette fois, ainsi que nous le verrons, en coupant celles-ci de ce qui est leur racine essentielle chez Guyau : la sociabilité, l'altruisme.
Steiner parle aussi de ces « emprunts » de Nietzsche dans la conférence du 21 août 1916 :
« Il suffit à nouveau d'aller dans sa bibliothèque et de prendre le livre de Guyau sur la morale. On lit les passages que Nietzsche a marqués dans la marge, et on les retrouve pris isolément dans Par-delà le bien et le mal. Ce texte est déjà entièrement contenu dans les exposés de Guyau sur la morale. Il faut vraiment tenir compte de pareilles relations à l'époque moderne. Si on n'en tient pas compte, on se fait des images toutes fausses de ce qu'était l'un ou l'autre des penseurs.[2] »
Il faut tout de suite bien préciser que, dans l'esprit de Steiner, cela ne devrait pas conduire à considérer Nietzsche comme une sorte de plagiaire psychopathe, même si cette dimension n'est pas à exclure totalement. De façon paradoxale, le génie de Nietzsche ne se situe pas dans le travail philosophique au niveau de la pensée, il est plutôt une sorte d'acteur, d'interprète tragique des espoirs et des contradictions des systèmes de pensée qui règnent dans la seconde moitié du XIXe siècle.
« Et cela devient son destin de vivre jusqu'au bout personnellement toute la félicité, mais aussi toute la souffrance que ces visions du monde peuvent engendrer lorsqu'elles se répandent sur tout l'être de l'âme humaine.[3] »
Intimement lié tout d'abord à la philosophie de la volonté de Schopenhauer, puis à la philosophie agie dans l'art de Richard Wagner, il va développer une sorte de rejet de tout système intellectuel et il en viendra même à nier le bien-fondé de la recherche de la vérité. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il semble s'autoriser n'importe quel emprunt puisque, dans son sens, c'est le dynamisme qu'il imprime aux idées qui compte et non ces idées elles-mêmes. Mais nous verrons comment ce refus de la pensée peut conduire à une perte de la liberté.
En tout cas les remarques de Steiner devraient éveiller la curiosité, en particulier celle du lecteur français, sur qui fut ce Guyau dont la morale semble avoir été utilisée, voire éclipsée, par Nietzsche. Pratiquement aucun biographe ou exégète nietzschéen n'accorde d'importance à ce problème ; certains se sont même employés à nier toute influence.
Guyau fut-il un simple marchepied sans valeur propre pour servir aux envolées de Nietzsche ? Ou bien fut-il plus que cela ?
L'honnêteté intellectuelle nous obligerait déjà à aller y voir... Il existe de plus une mention de la relation Guyau/Nietzsche — toujours de Rudolf Steiner ! — qui vient donner à toute cette affaire une autre dimension encore, assez énigmatique, il faut bien l'avouer, mais qui nous rapprochera du vif du sujet. Cette mention se trouve dans ce qu'on appelle les Documents de Barr, rédigés en septembre 1907 par Steiner pour répondre à des questions d'Édouard Schuré, l'auteur de Les grands initiés. À la fin du bref Document II, après qu'il a été question de l'initiation rosicrucienne, puis de l'initiation mystique-chrétienne, est évoquée « l'initiation de Manès » comme degré supérieur au sein de tout ce courant :
« (...) elle consiste dans la connaissance véritable de la fonction du mal. Cette initiation, avec ses arrière-plans, doit encore longtemps rester cachée au plus grand nombre. Car là où un seul petit rayon de lumière venant d'elle s'est infiltré dans la littérature, il en résulta des malheurs ; ainsi par le noble Guyau, dont Friedrich Nietzsche devint l'élève.[4] »
La dernière phrase pose quelque problème d'interprétation, car, au sens courant, on ne peut pas dire que Nietzsche devint l'élève de Guyau, il s'en serait défendu ! Ils ne se sont jamais rencontrés. S'agit-il alors d'une formule un peu rapide pour exprimer les emprunts dont il a été question ? Ou bien y a-t-il ici une allusion à quelque discipulat de nature plus suprasensible, dans l'aura de cette initiation manichéenne ?
Ainsi donc, d'un côté, ce dialogue philosophique entre Guyau et Nietzsche nous entraîne vers des hauteurs inattendues. Or, de l'autre côté — et ce sera peut-être là surtout l'apport de cet article — ce rapprochement-opposition des pensées va se doubler, au niveau le plus concret de la vie physique, d'un rapprochement géographique des deux penseurs, sans que ceux-ci en aient eu conscience. En effet, entre 1883 et 1888, Guyau et Nietzsche vont pendant vingt-six mois se frôler, si l'on peut dire, à Nice et à Menton. Cette proximité, qui ne débouche toutefois pas sur une rencontre, me paraît faire un tout avec le niveau philosophique, ou le niveau ésotérique, de cette relation. Et, dans ce sens, la vision privilégiée de ces trois couches différentes de ce qui fait une biographie m'a paru former une bonne base pour méditer sur les mystères de la destinée, du karma, en bref de la biographie, qui déborde de toutes parts vers le passé et vers l'avenir, qui est faite des « non-rencontres » tout autant que des rencontres.
AU SOIR DE L'ÂGE OBSCUR SUR LA CÔTE D'AZUR...
À vrai dire, cette région ne s'appelait pas encore « Côte d'Azur » ; c'était la Riviera, éventuellement la Riviera provençale, ou française, pour la distinguer de la Riviera italienne. Certes, en ces lieux où sont fortement implantés aujourd'hui les cultes du dieu « Casino » ou de la déesse « Cinéma », on a quelque difficulté à voir un haut-lieu du débat philosophique, et plus particulièrement de la « Morale ». Pourtant, un certain génie du lieu semble être en rapport avec les questions extrêmes qui concernent la liberté, le bien et le mal, le combat spirituel... Il suffit, pour s'en persuader, de faire la route entre Nice et Menton, là où les Alpes plongent presque à la verticale dans la mer, justifiant cette appellation devenue usuelle mais riche de sens seconds : « les Alpes Maritimes ». Ou bien il faut se rappeler l'École de Lérins au Ve siècle de notre ère, haut lieu du « semi-pélagianisme », où étaient débattues toutes les questions relatives au libre-arbitre. C'est là aussi que Faust (de Riez) exhortait les moines en formation au Combat Spirituel... Et peut-être n'est-ce pas un hasard non plus si un troisième philosophe moral de la fin du XIXe siècle, un Russe cette fois, aura à Cannes, en 1899, l'inspiration de son œuvre ultime : Trois conversations, qui se terminent par le Court récit sur l'Antéchrist. Il s'agit de Vladimir Soloviev, qui rédigea d'ailleurs là la première conversation : Sur la guerre. Quant au moment, nous sommes alors au terme du Kali-Youga, cet Âge Obscur d'une durée de 5000 ans qui, d'après les textes orientaux, avait débuté au mois de février de l'an 3102 av. J.-C. et qui allait se terminer en 1899 (Il n'y a pas d'an 0 dans la chronologie historique !). Au cours de cette période, l'homme s'est de plus en plus lié à son cerveau, à la pensée cérébrale, aboutissant à un obscurcissement total de la vision spirituelle. Dans ce sens il faut saluer chez Nietzsche, chez Guyau aussi, cette honnêteté, cette cohérence intellectuelle qui leur fait refuser tout système transcendantal a priori, toute révélation, et l'on peut comprendre aussi pourquoi Steiner se sent si proche à cette époque des penseurs agnostiques, des individualistes athées qui ont le courage d'affronter la solitude, le doute, l'absence de repères extérieurs et qui vont chercher au fond d'eux-mêmes le point d'appui de leur démarche. Ce fait de ne tenir compte que de ce qui a été pleinement expérimenté par l'individu, et non simplement pensé superficiellement, ou supposé ou emprunté, est une tonalité fondamentale du manichéisme (au sens noble du terme). L'auteur de la Philosophie de la liberté (1893) cherchera, lui aussi, ce point-zéro de la connaissance, et ce n'est qu'après l'avoir atteint qu'il déploiera à partir de ce centre quelque chose qui, coupé de cette origine, pourrait apparaître comme une révélation extérieure.
Il y a bien là, au bout de cet Âge Sombre, avant le début d'un Âge Clair ou Lumineux (potentiel !), une extrême intensification de cette descente vers la matière, et c'est dans la lutte qu'il faut arracher le germe de l'avenir. En même temps, depuis 1879 a débuté l'Ère de Michaël, une période de 360 ans environ, de nature solaire. Toutefois, il faut noter que s'il y eut quelque chose comme un éclaircissement des mondes spirituels, l'inauguration de cette Ère est en rapport avec ce que Steiner appelle « la chute des esprits des ténèbres » : au terme d'un combat dans les mondes spirituels s'étendant de 1841 à 1879, des esprits des ténèbres, des entités ahrimaniennes en particulier, sont précipités dans l'humanité, dans les pensées, dans les âmes humaines.
Ces vingt années qui vont de 1879 à 1899 sont donc, de maintes manières, une zone de clair-obscur, un moment intense de confrontation entre ténèbres et lumière. On peut parler d'une sorte d'écartèlement ou de dissociation entre la partie lumineuse et la partie sombre, et nous verrons que ce phénomène aussi, Nietzsche l'a incarné de façon personnelle.
« LE VOYAGEUR ET SON OMBRE »
Tel est le titre d'un texte de Nietzsche, de 1879 justement, inclus par la suite dans Humain, trop humain, et qui peut imager cet écartèlement. C'est en 1879 qu'il quitte l'Université de Bâle et la philologie, entre autres pour des raisons de santé, et dès lors il va chercher avec une certaine frénésie les lieux ensoleillés, dans les Alpes suisses, en Italie, sur la Riviera française. Il ne saurait être question de tenter ici une biographie résumée, mais il apparaît nécessaire de signaler trois éléments sans lesquels on ne peut guère comprendre la dernière période de la vie de Nietzsche.
Il faut tout d'abord mentionner « l'horoscope spirituel ». Dans les conférences de 1914 Pensée humaine, pensée cosmique — lesquelles, notons-le au passage, sont de nature à révolutionner complètement l'astrologie actuelle —, Steiner montre l'importance de cet horoscope spirituel, qui n'est pas basé sur le moment de la naissance physique, en ce qui concerne le lien de l'homme aux diverses conceptions du monde (douze conceptions fondamentales, nuancées par sept tendances de l'âme) ; à titre d'exemple, il développe particulièrement le cas de Nietzsche[5] . Sans entrer ici dans les détails, indiquons seulement que sa dernière période de création est marquée par un glissement vers un « Mars en Scorpion », ce qui, en termes de conceptions du monde, se dit : « volontarisme dans le dynamisme » ; or les forces des constellations sombres du Zodiaque (du Scorpion aux Poissons) ne peuvent être vécues de façon positive que si est effectué un travail de nature spirituelle ; sans quoi c'est leur aspect négatif qui seul s'exprime. C'est là une clé essentielle pour aborder le destin de Nietzsche, car ses dernières œuvres sont vraiment l'expression de cette force volontaire, où tout est vécu en termes de forces, de puissance, mais dans un système qui tourne en rond, pour ainsi dire, jusqu'à aboutir à la répétition quasi-obsessionnelle : « volonté de puissance », « décharger la puissance », « surhomme », « philosophie à coups de marteau », « déclarer la guerre », etc. Au sens propre, il n'est plus que « Mars en Scorpion », mais enfermé dans la partie la plus instinctuelle, la plus mécanique, la moins libre, de cette sphère qui recèle aussi des forces de guérison.
Deuxième élément : dans la conférence du 11 novembre 1917[6], Steiner indique le fait que Nietzsche, exposé au danger de succomber à l'inspiration d'entités ahrimaniennes, a reçu l'aide spirituelle de Richard Wagner après que ce dernier eut quitté le plan physique le 13 février 1883. Et — aussi paradoxal que cela puisse paraître — c'est grâce à cette aide que Nietzsche a perdu la raison, que sa conscience s'est détachée de son corps ; c'est de cette façon qu'il échappa à l'emprise des forces néfastes. Nous retiendrons donc qu'entre 1883 et 1889 Wagner est censé tenter d'apporter cette aide à partir des mondes spirituels.
Toutefois — et c'est le troisième élément que nous signalerons — cette inspiration des esprits des ténèbres a pu s'exercer, et, par exemple dans la conférence du 8 août 1924[7], Steiner affirme ce fait, qui marque réellement un tournant dans l'histoire de la civilisation :
« C'est seulement alors que l'on a pris connaissance de ce que Nietzsche a écrit à l'époque de son effondrement. Il s 'agit avant tout de deux œuvres, L'Antéchrist et Ecce Homo : ce sont là deux œuvres qu'Ahriman a écrites, pas Nietzsche, mais un esprit ahrimanien incorporé en Nietzsche. C'est alors qu'Ahriman apparut pour la première fois en tant qu'écrivain. Il poursuivra cela. »
Ces trois aperçus, qui certes seraient à développer, peuvent faire entrevoir dans quelle situation intérieure dramatique Nietzsche arrivera à Nice au mois de décembre 1883. Il est alors à la moitié de son Zarathoustra :
« L'hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice, qui, alors, illuminait pour la première fois ma vie, je trouvai le troisième Zarathoustra, — et j'avais fini. A peine un an pour le tout. Bien des endroits cachés, bien des hauteurs des environs de Nice sont pour moi sanctifiés par d'inoubliables instants ; cette partie capitale intitulée « D'anciennes et de nouvelles tables » fut composée au cours de la très pénible montée de la gare au merveilleux nid d'aigle maure d'Èze, — l'agilité des muscles a toujours été chez moi d'autant plus vive que la force créatrice débordait avec plus d'impétuosité. C'est le corps qui connaît l'enthousiasme : laissons « l'âme » hors de tout cela... On aurait souvent pu me surprendre en train de danser ; à cette époque, je pouvais, sans trace de fatigue, marcher sept ou huit heures en montagne. Je dormais bien, je riais beaucoup —, j'étais plein de vigueur et d'une patience à toute épreuve...(Ecce Homo)[8] »
JEAN-MARIE GUYAU


Il est temps de faire entrer dans notre champ de vision « le noble Guyau ». Jean-Marie Guyau est né le 23 octobre 1854 à Laval (Mayenne). Un drame conjugal entre ses parents rend nécessaire la séparation dès 1855, et c'est un cousin par alliance de la mère qui va bientôt occuper la place paternelle auprès de l'enfant : il s'agit d'Alfred Fouillée, encore très jeune alors, et qui deviendra agrégé de philosophie puis sera connu pour sa philosophie des « idées-forces ». L'enfant grandit dans un milieu laïque, voire anticlérical, et où tout le monde écrit : sa mère est l'auteur, sous le pseudonyme de G. Bruno, du fameux Tour de France par deux enfants, ainsi que d'autres ouvrages. L'esprit philosophique de Jean-Marie se manifeste déjà à quinze ans lorsqu'il doit servir de secrétaire à son « beau-père » Fouillée qui a de graves troubles oculaires, pour la rédaction d'un ouvrage sur la Philosophie de Platon ; d'après Fouillée, il montre alors une étonnante faculté à « platoniser ». A vingt ans il obtiendra une chaire d'enseignement mais, au bout d'un an seulement, sa mauvaise santé mettra fin à cette carrière.
Ces problèmes de santé, ainsi que ceux de Fouillée, obligent la famille à rechercher des climats plus ensoleillés ; ce sera d'abord le Sud-Ouest (Pau et Biarritz), puis le Sud-Est à partir de 1876 : Menton pendant un an, puis Nice pendant quatre ans, et Menton à nouveau de 1882 à 1888.
Après un ouvrage sur la morale d'Épicure (1878), Guyau écrit un livre sur La morale anglaise contemporaine (1879), qui attirera sur lui l'attention du monde philosophique, en France et à l'étranger. Il y a là une confrontation avec les idées évolutionnistes, auxquelles il veut apporter une correction en montrant que la vie est généreuse par essence et non pas seulement par accident. Il y a ensuite une phase au cours de laquelle il se tourne plus vers les problèmes d'esthétique et où il publie un ouvrage de poésie, Vers d'un philosophe (1881). On peut voir ici un certain parallélisme avec l'évolution de Nietzsche qui, à cette même époque, veut sortir de la structure intellectualiste par la voie du lyrisme (Zarathoustra). Guyau se marie, et un garçon naît à l'automne 1883.
Au cours des quatre années qui lui restent à vivre il va publier les deux ouvrages où apparaît le plus nettement son originalité philosophique, les deux ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque de Nietzsche et que ce dernier dut vraisemblablement acquérir à la librairie Visconti de Nice[8a] dès leur parution : Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction (1885) et L'irréligion de l'avenir (1887). Déjà les seuls titres ont une tonalité légèrement intempestive, ou subversive, qui pourrait prêter à bien des malentendus. On pourrait imaginer quelque attitude de rébellion par rapport à la morale, un appel à l'immoralisme, doublé d'un appel à l'impiété. Rien n'est plus étranger au ton et au contenu de ces livres. Mais le propos, s'il n'a rien de provocateur ni de destructeur — comme chez Nietzsche — met sans cesse le lecteur — et ceci avec grâce et limpidité — devant ses deux responsabilités majeures : la plus grande indépendance personnelle et, en même temps, la plus grande sociabilité. Et cela est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à écouter vraiment, et à pratiquer.
« Une morale positive et scientifique ne peut faire à l'individu que ce commandement : Développe ta vie dans toutes les directions ; sois un individu aussi riche que possible en énergie intensive et extensive ; pour cela, sois l'être le plus social et le plus sociable.[9] »
De ce type de phrase Nietzsche ne gardera que la première partie car il ne voit pas ce qui pourrait justifier ce lien de complémentarité entre l'individuel et le social. Il refuse cette intuition qui, chez Guyau, est entre autres le fruit d'une critique de l'évolutionnisme utilitariste, et par contre il va pousser jusqu'à leurs dernières conséquences les idées de la lutte pour la vie. Sur la page de titre de son exemplaire de l'Esquisse, il écrit :
« Ce livre contient une erreur comique : dans sa tentative de démontrer que les instincts moraux ont leur siège dans la vie elle-même, Guyau n'a pas vu qu'il a prouvé le contraire — à savoir que tous les instincts fondamentaux de la vie sont immoraux, y compris ceux que l'on dit moraux.[10] »
Et il poursuit sur la volonté de puissance. A. Fouillée note :
« Ce qu'il y a de curieux ici, c'est l'illusion d'optique par laquelle la contradiction entre Guyau et Nietzsche paraît à ce dernier une contradiction entre Guyau et Guyau lui-même.[11] »
La limite de la philosophie de Guyau, c'est qu'il ne peut démontrer de façon indiscutable sur le plan de la pensée qu'existe cet altruisme, cette générosité qu'il ressent si intensément :
« Vie, c'est fécondité, et réciproquement la fécondité, c'est la vie à pleins bords, c'est la véritable existence. Il y a une certaine générosité inséparable de l'existence, et sans laquelle on meurt, on se dessèche intérieurement. Il faut fleurir ; la moralité, le désintéressement, c'est la fleur de la vie humaine.[12] ».
Mais y aura-t-il jamais une démonstration scientifique de l'existence de l'amour ? Guyau affirme de tout son être que la vie peut être vue de cette manière et il introduit en philosophie une dimension nouvelle. Deux jugements sur Guyau vont nous permettre d'approcher cela. D'abord Émile Faguet, qui écrit en 1895 :
« Personne ne fut plus profondément aimant que Jean-Marie Guyau. Ses prénoms étaient bien choisis. Ils furent comme une sorte d'horoscope. Guyau était tout amour. Il semble que le moi le gênât. Il ne songeait qu'à le répandre. “Vivre en autrui” aurait pu être sa devise. (...) La passion du non-moi est si rare qu'elle n'a pas de nom très précis en aucune langue. Il l'eut sans cesse. Cette tendance maîtresse a comme modelé la pensée de Guyau tout entière. De toutes choses il se demande ce que ce qu'il examine contient de social, et il mesure tout à cette mesure, et il redresse, rectifie, renouvelle et agrandit tout par l'intervention de cette pensée.[13] »
Il faut préciser toutefois que cette attitude allait de pair avec un réel individualisme éthique, et l'on voit d'ailleurs bien ces deux qualités se lier dans le jugement de Fouillée :
« Ses qualités de penseur et d'écrivain procèdent toutes d'une qualité qui est maîtresse en philosophie comme en littérature : l'absolue sincérité. Cette sincérité aborde courageusement tous les problèmes, va à l'encontre des idées reçues sans se soucier de ce qu'on pourra penser et dire, sans autre préoccupation que de se mettre en présence de la réalité, comme le croyant se met “en présence de Dieu”. Et pourtant que de regrets et de tristesses pour celui qui doute de ce qui lui paraîtrait le plus doux à croire, qui ébranle ce qu'il aurait voulu conserver ! Notre philosophe n'en garde pas moins jusqu'au bout l'abnégation et le détachement de soi :
Le vrai, je sais, fait souffrir,
Voir, c'est peut-être mourir ;
N'importe ! Ô mon œil, regarde !
(dans Vers d'un philosophe)
Sa pensée, sans dessein préconçu de soutenir tel système ou de combattre tel autre, s'aventure seule à la recherche de ce qui est, avec les hardiesses et les angoisses de celui qui voyage sans compagnon ; il n'essaye pas plus de vous faire illusion sur ce qu'il n'a pu découvrir que sur ce qu'il a cru trouver ; la limite qu'il n'est pas parvenu à franchir, il la marque lui-même ; l'objection qu'on peut lui faire, il la fait tout le premier et vous dit d'avance : voilà ce que je ne puis éclaircir. S'il se met parfois en scène, c'est pour vous y mettre vous-même : c'est le moi humain qu'il a étudié en lui ; il n'a pas dessein de vous intéresser à sa personnalité, mais à la vôtre.[14] »
Le passage, exprimé par Steiner, des idées essentiellement altruistes de Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction à la négation totale de la morale de Par-delà le bien et le mal, que Nietzsche termine au début de 1886, est un sujet très complexe qui dépasserait le cadre de cet article surtout destiné à évoquer les circonstances biographiques de ces emprunts. Et il faut dire que la notion même d'emprunt est à prendre ici cum grano salis. Il n'y a pas de doute que Nietzsche a lu et fortement annoté Esquisse (…) il laisse transparaître par quelques remarques son intérêt pour les idées de Guyau (qu'il décrit comme « Parisien », les ouvrages étant édités à Paris). Mais dans ses ouvrages proprement dits il ne se réfère pas à Guyau. Par ailleurs, il est vrai aussi que plusieurs des idées qu'il développe étaient déjà présentes avant cette lecture, à tel point que Fouillée, le « beau-père » de Guyau, dans son ouvrage sur Nietzsche et l'immoralisme — où il étudie en détail les annotations de Esquisse — n'en vient pas du tout à crier au plagiat ; il analyse méthodiquement les différences, et c'est seulement dans une note qu'il dit :
« Les théories du penseur allemand sont en partie une déviation des doctrines que Guyau avait déjà soutenues ; il importe donc au plus haut point de rétablir le vrai et le normal sous certaines altérations pathologiques qui, grâce au génie littéraire de Nietzsche, peuvent séduire tant de simples ou tant de raffinés à la recherche du neuf.[15] »
C'est qu'en effet l'écriture de Par-delà le bien et le mal (1886), de même que celle de la Généalogie de la morale, qui suivra en 1887, est particulièrement brillante. Et l'on peut déjà nettement percevoir l'inspiration négative, mais géniale, qui se déploiera encore plus complètement dans les œuvres de la fin 1888.
La question de « l'emprunt » devient alors plus subtile. Il est à peine sensible sur le plan purement formel — bien que notable pour tout observateur honnête — et c'est pourquoi beaucoup de commentateurs ont pu le nier. Mais il se passe à un niveau plus profond ; c'est quelque chose comme une inversion d'une impulsion spirituelle. L'impulsion destructrice dont Nietzsche devient le véhicule se nourrit en quelque sorte de la substance morale des idées de Guyau. Il y a là une génialité dans la façon même d'absorber, d'occulter une impulsion, et donc précisément ce « petit rayon » venu de hautes sphères spirituelles. Fouillée a bien sûr senti quelque chose du problème, mais — et c'est là un problème insoluble sans la dimension ésotérique — il ne peut distinguer l'homme Nietzsche de ce qui s'empare de Nietzsche, et par ailleurs il ne peut que reconnaître chez Nietzsche un esprit qui, par bien des traits, est proche de celui de Guyau.
Dans L'irréligion de l'avenir Guyau est à nouveau sur le fil du rasoir. Si, d'un côté, il veut montrer la caducité des dogmes extérieurs et des révélations, il se démarque tout autant des candidats à l'organisation de « la religion de l'avenir », et il critique en particulier le système d'Eduard von Hartmann. Cela est intéressant à noter car, exactement à la même époque, un certain Steiner écrit son premier ouvrage (Épistémologie de la pensée goethéenne) en se confrontant lui aussi à la philosophie de Hartmann. Il faut noter chez Guyau cette idée très manichéenne — au sens noble du terme — qu'il faut rechercher ce qui est au cœur le plus profond des religions et se défendre des œcuménismes superficiels et artificiels, qui déjà se dessinaient et qui ont aujourd'hui envahi notre atmosphère culturelle.
Dans la préface il tâche de prévenir les malentendus que pourrait amener le titre :
« Les éléments qui distinguent la religion de la métaphysique ou de la morale, et qui la constituent proprement religion positive sont, selon nous, essentiellement caducs et transitoires. En ce sens, nous rejetons donc la religion de l'avenir comme nous rejetterions l'alchimie de l'avenir ou l'astrologie de l'avenir. Mais il ne s'ensuit pas que l'irréligion ou l'a-religion — qui est simplement la négation de tout dogme, de toute autorité traditionnelle, et surnaturelle, de toute révélation, de tout miracle, de tout mythe, de tout rite érigé en devoir — soit synonyme d'impiété, de mépris à l'égard du fond métaphysique et moral des antiques croyances. Nullement ; être irréligieux ou a-religieux n'est pas être anti-religieux. Bien plus, comme nous le verrons, l'irréligion de l'avenir pourra garder du sentiment religieux ce qu'il y avait en lui de plus pur : d'une part l'admiration du Cosmos et des puissances infinies qui y sont déployées ; d'autre part, la recherche d'un idéal non seulement individuel, mais social et même cosmique qui dépasse la réalité actuelle.[16] »
On comprend que le problème posé ici sera très proche de celui de la morale, puisque l'homme devra faire ici le même type de chemin : à travers un individualisme libre de tout a priori d'un côté, et, de l'autre côté, avec ce sens de la sociabilité qui s'élargira même ici jusqu'à une dimension cosmique. Mais Guyau a l'art de dire ces choses d'une façon intime et concrète qu'il faut lire dans le texte ; par exemple :
« Un jour que j'étais assis à ma table de travail, mon amie est venue à moi tout inquiète : Quel front triste ! Qu'as-tu donc ? Des larmes, mon Dieu ! T'ai-je fait de la peine ? — Eh, non, m'en fais-tu jamais ? Je pleure d'une pensée, tout simplement, oui, d'une pensée en l'air, abstraite, d'une pensée sur le monde, sur le sort des choses et des êtres. N'y a-t-il pas dans l'univers assez de misère pour justifier une larme qui semble sans objet, comme assez de joie pour expliquer un sourire qui semble naître de rien ? Tout homme peut pleurer ou sourire ainsi, non sur lui, ni même sur les siens, mais sur le grand Tout où il vit, et c'est le propre de l'homme que cette solidarité consciente où il se trouve avec tous les êtres, cette douleur ou cette joie impersonnelle qu'il est capable d'éprouver. Cette faculté de s'impersonnaliser pour ainsi dire est ce qui restera de plus durable dans les religions et les philosophies, car c'est par là qu'elles sont le plus intérieures.[17] »
C'est donc sans doute au cours de son dernier séjour à Nice (automne-hiver 1887-1888) que Nietzsche acquit et lut L'irréligion de l'avenir. L'étude des annotations s'avère problématique du fait que la personne chargée de relier le livre pour les Archives Nietzsche s'est fait un devoir d'effacer les annotations ! Ce qui fait qu'il n'y a peut-être qu'une seule personne qui ait pu lire celles-ci, à savoir... Steiner !
Mais l'on peut bien envisager que là encore, eut lieu une sorte « d'inversion des valeurs », notion si présente dans les derniers écrits nietzschéens, s'appuyant sur la recherche si nuancée et si respectueuse de ce qui est l'essence du sentiment religieux et aboutissant à la philosophie à coups de marteau : Le crépuscule des idoles, L'Antéchrist, Le cas Wagner, Ecce Homo. C'est la terrible moisson de l’année 1888. Ici, à nouveau, il ne faut pas tant rechercher les traces formelles d'emprunts, c'est à nouveau à la source de l'impulsion qu'il faut envisager le processus de substitution. Nous sommes en présence d'un processus de substitution occulte : techniquement, tout ce qui reflète une inspiration chrétienne, ou manichéenne, fait l'objet d'une attaque : Wagner, dont le Parsifal avait été le début de la discorde avec Nietzsche, le Christ et le christianisme. Les lettres qu'il écrit à Brandes en novembre et décembre 1888 sonnent comme des autosatisfecit... mais de qui ?
« Avec un cynisme qui prendra l'allure d'un événement de l'histoire universelle, je me suis raconté moi-même. Le livre s'appelle Ecce Homo, et c'est un attentat sans aucun ménagement contre le Crucifié ; il finit dans un fracas de tonnerre et de fulminations contre tout ce qui est chrétien ou infecté de christianisme, à vous assourdir et à vous aveugler complètement. En fin de compte, je suis le premier psychologue du christianisme, et, en vieil artilleur que je suis, je peux mettre en batterie des pièces de gros calibre dont aucun des adversaires du christianisme n'avait jusqu'ici soupçonné l'existence. Le tout est le prélude de l’Inversion de toutes les valeurs, cette œuvre que j'ai déjà devant moi, achevée : je vous jure que dans deux ans, nous aurons plongé la terre entière dans des convulsions. Je suis une fatalité.[18] »
« (…) Nous venons d'entrer dans la grande politique, et même la très grande... Je prépare un événement qui, selon toute vraisemblance, va briser l'histoire en deux tronçons, au point qu'il nous faudra un nouveau calendrier, dont 1888 sera l'An I. Tout ce qui, aujourd'hui, tient le haut du pavé, « Triple Alliance », « question sociale », s'effacera au profit d'une position individuelle d'opposition : nous aurons des guerres comme il n'y en a pas eu, mais pas entre nations, pas entre classes : toutes ces distinctions voleront en éclats —je suis la dynamite la plus dangereuse qui soit. »
« (…) Mon livre est comme un volcan : rien de ce qui s'est écrit auparavant ne donne une idée de ce qu'on y trouve, ni de la manière dont les mystères les plus profonds de la nature humaine y sont brusquement révélés avec une aveuglante clarté. II y a là une manière de condamner à mort qui est proprement surhumaine. Et pourtant, il souffle sur tout cela un calme et une hauteur grandioses — c'est vraiment un jugement dernier, bien qu'il n'y ait rien qui soit tenu pour trop infime ou trop négligeable pour y être considéré et exposé en pleine lumière. Quand, enfin, vous lirez la loi contre le christinanisme, signée « l'Antéchrist », qui termine ce livre, vous aussi, je le crains, vous tremblerez comme une carcasse... Si nous sommes vainqueurs, nous aurons entre nos mains le gouvernement de la terre, y compris la paix universelle.[19] »
LA NON-RENCONTRE
Ce qui rend d'autant plus poignant le drame qui se déroule dans l'invisible entre Nietzsche et Guyau, c'est leur proximité géographique. On doit à Robert Vellerut d'avoir reconstitué, dans deux articles parus dans le Nice historique en 1965 et en 1968, la chronologie des séjours de Nietzsche d'une part, de Guyau d'autre part, comblant ainsi une lacune qui frise l'occultation chez les biographes de Nietzsche. Au cours des vingt-six mois que ce dernier passa à Nice et Menton, c'est le mois de novembre 1884 qui semble se prêter à un rapprochement maximal de nos deux penseurs, qui habitent alors Menton, et Vellerut d'imaginer :
« On peut rêver à une image émouvante : Nietzsche et Guyau, proches l'un de l'autre sur les Rochers Rouges mais trop perdus dans leurs méditations solitaires pour engager une conversation entre inconnus.[20] »
On peut même rêver d'une rencontre, car comment douter qu'au-delà du drame en cours, il existait une réelle parenté, osons dire une fraternité, entre les deux penseurs ?
Évoquons encore deux moments qui marquèrent, de façon différente, les deux biographies.
Le 23 février 1887, c'est le jour du Mardi-Gras, on fête à Nice le Carnaval jusqu'à la nuit tombée. Dans la nuit du 23 au 24, au petit matin du Mercredi des Cendres, la terre tremble à plusieurs reprises. C'est l'affolement général ; les gens descendent dans la rue ; Nietzsche déambule. Il écrit le lendemain à Peter Gast :
« Cher ami, peut-être la nouvelle de notre tremblement de terre vous a-t-elle inquiété ? Voici un mot qui vous dira du moins ce qu'il en est de moi. La ville regorge de gens dont le système nerveux est ébranlé, la panique dans les hôtels est à peine concevable. Cette nuit, vers deux ou trois heures, j'ai fait un tour et visité quelques personnes amies, qui en plein air, sur des bancs ou dans des fiacres, croyaient se préserver du péril. Pour moi, je vais bien. Absence complète de frayeur — et même pas mal d'ironie ! [21] »
À Menton le tremblement de terre a touché la maison des Guyau, et la famille est obligée de trouver refuge dans une maisonnette froide et humide où l'état de santé (maladie pulmonaire) de Jean-Marie va s'aggraver.
Il succombera un an plus tard, le 31 mars 1888, âgé de trente-trois ans. Son agonie commence le soir du Vendredi Saint. L'âge, les dates, l'atmosphère qui règne... le très laïque Fouillée rend avec émotion le mystère de ce moment :
« La veille du 31 mars, cet esprit infatigable avait travaillé encore : il dicta quelques pages. Le soir, quand il se coucha, il était encore plus las, plus épuisé que les soirs précédents. Pendant la nuit, il laissa pour la première fois sentir aux siens qu'il ne s'était fait aucune illusion sur sa fin prochaine : “J'ai bien lutté”, disait-il ; puis voulant adoucir la seule peine qu'il ne fût plus en son pouvoir d'épargner aux autres : “Je suis content, ajouta-t-il à demi-voix — oh, absolument content ; ... il faut l'être aussi, vous tous...” Sa mère était accourue. Déjà il ne pouvait plus parler, mais, en apercevant celle à qui il devait ce qu'il y avait en lui de meilleur — une grande intelligence, un cœur plus grand encore, — il la regarda longuement et sourit : il avait mis toute sa pensée dans ce regard, tout son amour dans ce sourire. La main de sa mère saisit la sienne ; il répondit à son étreinte, et désormais, jusqu'à l'instant de la dernière séparation, ces deux mains ne devaient plus se quitter. Il continua de sourire aux trois personnes aimées qui l'entouraient et qui, dans une inexprimable angoisse, tenaient fixés sur lui leurs yeux, comme pour le retenir, le rattacher à elles et à la vie par la puissance du regard. Pendant ce temps l'enfant de quatre ans dormait dans son petit lit, sans se douter qu'il allait perdre ce qu'il avait de plus cher au monde ; et nous respections ce sommeil. Le père, lui, finit par abaisser ses paupières ; sa respiration, d'abord saccadée, devint plus douce et plus lente, puis plus lente encore, si faible qu'on l'entendait à peine ; à la fin, en un soupir imperceptible, elle s'éteignit.
(...) C'était la nuit du Vendredi Saint. Dans son livre sur L'irréligion de l'avenir, avec cet esprit de sympathie qu'il avait apporté à la critique même des religions, avec cette profonde intelligence de leur côté moral et poétique, il avait dit qu'on peut trouver une haute vérité dans le symbole du Christ : “le nouveau drame de la Passion s'accomplit dans les consciences, et il n'en est pas moins déchirant”. À voir cette figure aux nobles traits, tout empreinte de pensée, et dont la souffrance même n'avait pu altérer la douceur sereine, à voir la mère en pleurs, aussi pâle que son fils, on songeait malgré soi à quelque image du Christ descendu de la croix..
(…) On l'enterra le matin de Pâques. Les croyants, eux, célébraient par toute la terre l'espoir de la délivrance finale et le pardon tombé du haut d'une croix sur les hommes.[22] »
C'est ainsi que se terminait cette brève étape terrestre de trente-trois ans, qui, de maintes manières, fut un chemin de Perceval : élevé « à l'abri » des dogmes religieux par sa mère et le très sincère Fouillée, Jean-Marie Guyau, avec une absence d'a priori très rare, une absolue sincérité, recherche en l'homme le point d'appui d'une morale libre, et d'un sentiment religieux ne se fondant que sur la réalité. Et il découvre que l'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il s'ouvre aux autres.
Ce même jour de Pâques 1888, Nietzsche, dans sa chambre d'hôtel de Nice, fait les derniers préparatifs pour son départ — qui sera définitif — de cette ville. Le lendemain, il part vers Turin. Le train qui l'emmène passe juste au-dessous du cimetière où le corps de Jean-Marie Guyau repose depuis la veille. Encore plus solitaire sur la terre, il erre pendant trois jours, s'étant trompé de train à Savone. Pendant neuf mois encore, il va demeurer prisonnier d'une terrible inspiration, jusqu'à ce 3 janvier 1889 où il s'écroule à Turin.
1888 : LA MARQUE DE L'ANTÉCHRIST
Ce triple « 8 » est peut-être en rapport avec l'expression de la 8e constellation du Zodiaque, le Scorpion ou l'Aigle. Steiner indiquera que dès cette année-là toutes les conditions étaient réunies pour qu'éclate la guerre, qui finalement se déclenchera en 1914 seulement.[23] Et ce fut donc l'année où, pour la première fois dans l'histoire du monde, Ahriman agit en tant qu'écrivain.
À travers Nietzsche donc. Mais nous remarquerons qu'une autre œuvre paraît en cet automne 1888, qui s'est élaborée depuis 1884 aussi, et qui résulte, elle aussi, de la plus terrible inspiration antichristique : La doctrine secrète de H.P. Blavatsky. Bien qu'il s'agisse d'une autre sphère d'expression culturelle, combien de similitudes entre la destinée de Nietzsche et celle de Blavatsky !
Steiner témoignera toujours à leur égard la même attitude, qui pourrait paraître paradoxale, et même contradictoire, à première vue : reconnaître en eux des êtres d'une extrême sincérité, d'un immense courage, de réels combattants spirituels, mais, d'un autre côté, pointer qu'ils devinrent à un moment donné la proie, et dès lors les instruments, des entités antichristiques ; cela fait d'eux des martyrs de la civilisation de la fin du XIXe siècle. Un siècle après, quelle conscience avons-nous de ces drames de la conscience, à un moment où viennent à échéance des rencontres encore plus terribles avec les entités antichristiques ?
Or, aujourd'hui comme il y a un siècle, sont disponibles les forces thérapeutiques, les forces de résurrection nécessaires, à la condition que soit franchi consciemment, par un travail de conscience désormais indispensable, le seuil du monde spirituel.
1888. Au dernier jour de septembre, le lendemain de la Saint-Michel, l'inspirateur de Nietzsche a voulu promulguer « la loi contre le christianisme » et faire de ce 30 septembre le premier jour d'une nouvelle ère, où l'humanité vivrait coupée de l'inspiration du Christ.
Exactement six mois plus tôt, au dernier jour de mars, la veille de Pâques, par cette même porte qu'emprunteront Morgenstern et Steiner pour rejoindre les mondes spirituels, Jean-Marie Guyau quitte ce monde après y avoir introduit un « tout petit rayon de lumière » qui — même s'il « en résulta des malheurs » — ne doit pas être tenu sous le boisseau. En voulant résumer l'œuvre et la vie de Guyau, M. Brieux a osé dire simplement :
« Parce qu'il a vécu, il y a dans l'humanité un peu plus de pitié et d'amour.[24] »
Le vrai, je sais, fait souffrir ;
Voir, c'est peut-être mourir ;
N'importe ! Ô mon œil, regarde !
Jean-Marie Guyau (1854-1888) ; extrait des Vers d'un philosophe.
Notes
[1] Rudolf Steiner, Autobiographie (Tome II), Genève, Editions Anthroposophiques Romandes, 1979, pp. 25-26, traduction différente.
[2] Rudolf Steiner, L'Homme, une énigme, Genève, Editions Anthroposophiques Romandes, 1990, p. 254.
[3] Rudolf Steiner, Les énigmes de la philosophie (Volume II), Genève, Editions Anthroposophiques Romandes, 1991, p. 233.
[4] Rudolf Steiner, Documents autobiographiques, Genève, Editions Anthroposophiques Romandes, pp. 128-129.
[5] Rudolf Steiner, Pensée humaine, pensée cosmique, Paris, Triades, 1951, 4e conférence.
[6] Conférence du 11-11-1917, traduite dans Cahiers de médecine anthroposophique, 1991, no 50, pp. 2-19.
[7] Rudolf Steiner, Considérations ésotériques sur le karma (Tome III), Genève, Éditions Anthroposophiques Romandes, 1983, p. 215.
[8] Friedrich Nietzsche, Œuvres complètes (Tome VIII), Paris, Gallimard, 1974, p. 311.
[8a] En fait Nietzsche reçut le livre Esquisse… à Nice, mais par un envoi depuis un libraire de Leipzig ; pour le second livre, je n’ai pas d’information.
[9] Jean-Marie Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Paris, Fayard, 1985, p. 125.
[10] Cité dans Ilse Walther-Dulk, Materialien zur Philosophie und Aesthetik Jean-Marie Guyau's, Hamburg, 1965, p. 165.
[11] Alfred Fouillée, Nietzsche et l'immoralisme, Paris, Alcan, 1902, p. 154.
[12] Voir note 9, page 91.
[13] Émile Faguet (Débats du 30 mai 1895), cité par A. Fouillée dans La morale, l'art et la religion d'après Guyau, Paris, Alcan, 1918 (9e édition), p. 250.
[14] Alfred Fouillée, La morale, l'art et la religion d'après Guyau, Paris, Alcan, 1918, p. 191.
[15] Voir note Il, p. Il, note l.
[16] Jean-Marie Guyau, L'irréligion de l'avenir, Paris, Alcan, 1900 (7e édition), p. XIV (préface).
[17] Ibid. p. 337.
[18] Lettre à Brandes, du 20 novembre 1888, citée dans Friedrich Nietzsche, Œuvres complètes (Torne VIII), Paris, Gallimard, 1974, p. 393.
[19] Brouillon d'une lettre à Brandes, de décembre 1888, cité dans Friedrich Nietzsche, Œuvres complètes (Tome VIII), Paris, Gallimard, 1974, pp. 399, 400 et 401.
[20] Robert Vellerut, « Alfred Fouillée et Jean-Marie Guyau sur la Riviera », Nice historique, 1968 (pp. 8-27), p. 20. Voir aussi Robert Vellerut, « Nietzsche sur la Riviera », Nice historique, 1965, pp. 87-108.
[21] Friedrich Nietzsche, Lettres à Peter Gast, (Tome II), Monaco, Rocher, p. 238.
[22] Voir note 14, pp. 193 et 194.
[23] Voir conférence du 16-12-1916 dans Rudolf Steiner, Das Karma der Unwahrhaftigkeit (Erster Teil), GA 173, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1978.
[24] Cité par A. Fouillée dans Humanitaires et libertaires au point de vue sociologique et moral, Paris, Alcan, 1914, p. 50 (Note).
|
Les articles publiés sur le site www.soi-esprit.info ou a fortirori les billets publiés sur leurs blogs personnels, n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. |
 Courriers des lecteurs
Courriers des lecteurs